
L'histoire et les évolutions de la politique de la ville en France
 7 min
7 min
L'histoire et les évolutions de la politique de la ville en France
Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que l’idée d’une intervention publique dans le domaine du logement commence à émerger. En France, le développement de nombreux bidonvilles entraîne alors des problèmes sanitaires et sécuritaires majeurs. La question du logement devient d’autant plus pressante après la Seconde Guerre mondiale : les besoins sont si importants que l’intervention massive de l’État devient incontournable.
La politique de la ville naît du constat que certains territoires urbains concentrent des difficultés multiples : pauvreté, insalubrité, insécurité, isolement... Elle constitue une réponse publique visant à corriger les inégalités territoriales. Son objectif principal est de rétablir l’égalité républicaine dans les quartiers en difficulté, en améliorant les conditions de vie de leurs habitants. Ces quartiers sont souvent marqués par un chômage élevé, un fort taux de décrochage scolaire et un accès limité aux services publics, y compris aux soins. L’essor de cette politique est souvent stimulé par des événements marquants : manifestations, crises sociales ou drames humains.
Selon l’Observatoire national de la politique de la ville, les objectifs poursuivis sont multiples : réduction des inégalités, égalité réelle pour les habitants, dynamisation économique, amélioration de l’habitat, prévention, sécurité renforcée, intégration urbaine, cadre de vie de qualité, valorisation des habitants et de leur histoire, ainsi que promotion de l’égalité des chances.
Mais malgré ces ambitions et les nombreuses réformes entreprises depuis plus de 70 ans, la politique de la ville peine à enrayer durablement les inégalités et les tensions dans les quartiers prioritaires.
I. 1948-1976 : les débuts d’une politique publique du logement
De 1948 à 1976, plusieurs lois viennent structurer les premières interventions dans le domaine du logement : régulation des loyers, définition de normes pour le logement social, reconnaissance progressive du droit à un logement décent. En 1954, sous l’impulsion de l’abbé Pierre, 12 000 logements d’urgence sont construits pour les sans-abris. Puis, en 1971, Jacques Chaban-Delmas lance une politique de résorption des bidonvilles et de relogement des immigrés.
Ces premières mesures témoignent d’une volonté croissante de répondre aux besoins d’une population en pleine mutation, dans un contexte marqué par les conséquences de la seconde guerre mondiale et de la guerre d’Algérie.
II. 1977-1989 : une réforme du financement du logement social
Entre 1977 et 1989, de profondes réformes modifient le paysage du logement social. La loi de 1977 réorganise son financement en créant de nouveaux dispositifs comme les prêts d’accession à la propriété (PAP), les prêts locatifs aidés (PLA) et l’aide personnalisée au logement (APL), afin d’adapter les charges aux ressources des ménages.
La décentralisation engagée en 1982 confie aux communes la responsabilité de la planification urbaine et du logement social. L’État conserve un rôle actif à travers conventions et aides à la construction. Les départements, quant à eux, deviennent responsables des aides aux personnes les plus précaires.
III. 1990-2007 : du droit au logement au DALO
Dans les années 1990, de nouvelles réformes cherchent à renforcer l’accès au logement. La création du Fonds de solidarité pour le logement, du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (1992) ou encore du Samu social (1993) illustrent cette dynamique. En 1999, la loi SRU impose aux communes un quota de 20 % de logements sociaux pour promouvoir la mixité sociale.
La loi pour la ville et la rénovation urbaine de 2003 lance un programme ambitieux de réhabilitation, tandis que l’appel de l’abbé Pierre en 2004 relance le débat sur le droit au logement. En 2006, sous la pression de l’association Les Enfants de Don Quichotte, Jacques Chirac soutient la reconnaissance d’un droit au logement opposable (DALO), inscrit dans la loi en 2007. Ce droit permet aux demandeurs prioritaires de saisir la justice si aucune solution de logement ne leur est proposée.
IV. De 2007 à aujourd’hui : réponses à la crise du logement
À partir de 2007, les gouvernements successifs renforcent les politiques de logement. Le Président annonce une réforme des règles d’attribution des HLM, ciblant les ménages les plus modestes, et autorise la vente de logements sociaux à leurs locataires, en contrepartie de nouvelles constructions.
Le droit au logement opposable entre en vigueur en 2008. En 2009, la loi de mobilisation pour le logement met en place des sanctions contre les communes ne respectant pas leurs obligations en matière de logements sociaux. D'autres ajustements visent à faciliter le relogement des publics prioritaires, même si la concentration de la pauvreté reste un problème persistant.
Dans les années qui suivent, plusieurs lois structurent l’action publique : la loi ALUR (2014) réorganise les procédures d’attribution ; la loi ELAN (2018) vise à construire davantage, plus efficacement et à moindre coût. Le plan "France Relance" (2020) apporte un soutien financier pour rénover le parc social.
Cependant, malgré tous ces efforts, le DALO reste souvent inopérant : beaucoup de ménages prioritaires attendent encore un logement. La Cour des comptes souligne régulièrement l’écart entre les ambitions affichées et la réalité sur le terrain.
Dès lors, une question fondamentale se pose : la politique de la ville, dans sa forme actuelle, est-elle capable d’atteindre ses objectifs ? Faut-il opter pour une approche plus territorialisée, adaptée aux spécificités locales, ou au contraire renforcer une politique nationale cohérente et ambitieuse ? Enfin, comment enclencher une transformation réelle et durable des quartiers populaires sans tomber dans l’écueil d’actions ponctuelles et éparses ?
Ces interrogations invitent à repenser en profondeur l’avenir de la politique de la ville, pour qu’elle devienne enfin un véritable levier de justice sociale et de cohésion nationale.
Fanny Azan-Brulhet









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer












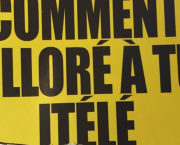

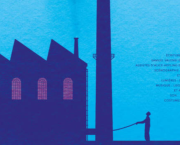
 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur





