
Sommes-nous condamnés à la méritocratie ?
 6 min
6 min
Sur Panodyssey, tu peux lire 10 publications par mois sans être connecté. Profite encore de 6 articles à découvrir ce mois-ci.
Pour ne pas être limité, connecte-toi ou créé un compte en cliquant ci-dessous, c’est gratuit !
Se connecter
Sommes-nous condamnés à la méritocratie ?
Qu'est-ce que la méritocratie ? C'est l’idée que celles et ceux qui réussissent le doivent uniquement à leurs qualités propres, et que la bonne fortune que veulent bien leur accorder les lois du marché est méritée.
L'idéal méritocratique fait partie de l’idéal républicain. L'enseignement délivré à tous doit favoriser l’égalité des chances, c’est-à-dire la liberté d’accéder aux fonctions souhaitées selon ses propres talents1. L’inégalité « naturelle » persiste, mais le critère change : à la naissance se substitue le mérite. Mais c'est oublier la persistance des déterminismes socio-culturels (Ne faut-il pas mieux s'appeler Grégory que Mohamed quand on est avocat ?).
Christophe Lasch va plus loin2 : « Quoique les avantages héréditaires jouent un rôle important pour l’obtention d’un statut dans les professions intellectuelles ou les cercles dirigeants de l’entreprise, la classe nouvelle doit préserver la fiction selon laquelle son pouvoir repose sur la seule intelligence […] d’où vient qu’elle a peu le sens d’une gratitude ou d’une obligation d’être au niveau de responsabilités héritées du passé. » Tous ces « méritants » seraient-ils indignes de leur situation ?
En guise de réponse, reprenons les propos de Nietzsche dans Le Gai Savoir. « L’homme le plus commun sent que la noblesse ne s’improvise pas et qu’il doit honorer en elle le fruit produit par de longues périodes, – mais l’absence de forme supérieure et la vulgarité tristement célèbre des industriels aux mains rouges et grasses le conduisent à penser que seuls le hasard et la chance ont ici élevé l’un au-dessus de l’autre : tant mieux, conclut-il par-devers lui, faisons nous aussi l’essai du hasard et de la chance ! Jetons donc les dés ! – et c’est le début du socialisme. ».
La méritocratie favorise l'individuation en promouvant l'idée que la réussite dépend uniquement du mérite individuel, c'est-à-dire de l'effort, du travail et des capacités propres à chacun. Ainsi notre situation professionnelle est perçue comme une réussite ou un échec dont nous sommes pleinement responsables, renforçant ainsi une logique où chaque individu est isolé dans sa course à la réussite. Michael Sandel3 y voit le danger d'une « anomie sociale », où les trajectoires individuelles l’emportent sur le vivre-ensemble. Dans une telle société, non seulement les inégalités seront justifiées, mais le bien commun et l’idée de vivre ensemble seront cassés. Les laissés-pour-compte perdront toute forme de dignité et de reconnaissance et tous ceux qui promettront de rendre de la dignité au peuple, en pointant des boucs émissaires, des étrangers aux élites woke, pourront emporter le morceau.
On aussi peut voir la méritocratie comme un processus d'embrigadement culpabilisant dans le seul but de disposer de travailleurs efficaces.
Raymond Aron dans son Essai sur les libertés a écrit : « La mobilité est plus grande qu’elle n’a jamais été et la démocratisation de l’enseignement augmentera les chances de promotion : oui, mais jadis la stabilité était la norme et l’improbabilité de l’ascension n’était pas éprouvée comme une privation. » Dorénavant, « les fils d’ouvriers et de paysans auront le sentiment d’être privés d’une liberté à laquelle chacun a droit, celle de choisir son existence ». Michael Young dans The Rise of the Meritocracy surenchérit « pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’homme qui se sait inférieur ne dispose d’aucun moyen commode de conserver malgré tout l’estime de soi »4.
Et que dire à ceux qui occupent des fonctions peu prestigieuses ? Une seule réponse : « Vous auriez pu vous élever mais vous ne l’avez pas fait. » Pourtant la société demande plus de caissiers, de « techniciens de surface » etc., que d'avocats, de médecins (même si il en manque).
Comment faire pour permettre à chacun de retrouver une égale dignité d'exister et sortir de la méritocratie ?
Faut-il remettre en question un capitalisme focalisé sur la performance économique et la concurrence, négligeant les conditions d’épanouissement humain et social ?
Faut-il revitaliser la République pour qu'elle mène des politiques publiques courageuses afin de réduire les inégalités réelles et promouvoir la justice sociale?
Faut-il revoir même la notion de travail5, ses finalités ?
On pourrait concevoir le travail non seulement comme une activité rémunérée mais aussi comme une contribution sociale plus large, incluant par exemple le travail non rémunéré ou bénévole, reconnu pour sa valeur sociale et humaine. En effet, cette « économie non marchande » permet d'autres formes de reconnaissance que la rémunération de son effort et pousse au développement de liens sociaux.
1Le talent découle d’un mélange inextricable entre don naturel déterminé par la génétique, environnement socio-culturel favorable et persévérance dans l’effort.https://philitt.fr/2017/05/31/alienation-et-crise-des-elites-les-limites-de-lideal-meritocratique/
2https://philitt.fr/2017/05/31/alienation-et-crise-des-elites-les-limites-de-lideal-meritocratique/
3« Ce que l’égalité veut dire » par Thomas Piketty et Michael J. Sandel Seuil, 2025
4Pour Young, l’inégalité des chances avait paradoxalement pour vertu de favoriser, d’entretenir le mythe de l’égalité entre les hommes. L’ouvrier se disait alors : « J’aurais pu être médecin mais je n’ai simplement pas eu cette chance. » Cela aurait été possible, mais dans un autre monde.
5https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuer
Contribuer


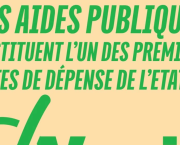


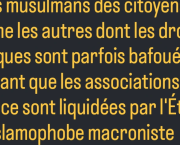

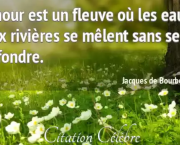
 Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur
Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur





