
Repenser la mondialisation agricole : de la sécurité alimentaire à la régénération des territoires
 7 min
7 min
Repenser la mondialisation agricole : de la sécurité alimentaire à la régénération des territoires
Une mondialisation née de la faim
La mondialisation agricole a émergé au début du XXe siècle comme une réponse logique aux aléas historiques de la production alimentaire. Pendant des siècles, les sociétés humaines ont été soumises à une instabilité chronique : sécheresses, maladies cryptogamiques, invasions de ravageurs… Rares étaient les années véritablement "normales". On estime qu’en Europe, à l’époque préindustrielle, une année sur quatre conduisait à la disette, une sur vingt-cinq à une famine, et une sur deux cents à une grande famine dévastatrice. Au final, seule une année sur cinq était normale. Face à cette insécurité structurelle, la mise en réseau des productions agricoles à l’échelle mondiale a permis de lisser les écarts : ce que l’un manquait, l’autre l’exportait. La faim a reculé. La sécurité alimentaire s’est installée dans les pays connectés. Aujourd’hui encore lorsqu’un nouveau pays accede à la capacité d’intégrer le réseau mondial agricole ses problèmes récurrents de famine disparaissent définitivement, comme on peut le voir dans la capture d'écran de Wikipédia que j'ai surlignée :

Il s’agit donc d’une solution puissante très performante, mais ce système a des revers et n’est pas sans conséquences.
L’uniformisation contre la vie
Pour que cette agriculture mondialisée fonctionne, il a fallu standardiser. Standardiser les espèces cultivées, pour qu’elles soient compatibles avec la transformation industrielle, la logistique, et les exigences du marché. Cette recherche de "miscibilité" des productions a entraîné une attrition massive de la biodiversité. Les variétés anciennes, souvent résilientes, adaptées localement, ont été abandonnées au profit de quelques cultivars, à haut rendement mais fragiles et dépendants d’intrants chimiques. Engrais, pesticides, herbicides sont devenus indispensables. La logique productiviste s’est imposée, ouvrant la voie à l’exploitation d’OGM adaptés à ces traitements. La biodiversité végétale s’est trouvée chamboulée, favorisant des espèces adventices résistantes qui ont nécessité d’autres herbicides, accelerant encore l’attrition de la biodiversité végétale et contaminant d’autant l’environnement, amenant érosion des sols, pollution des nappes phréatiques, effondrement dramatique de la biodiversité animale, insectes, oiseaux comme mammifères. Et une vulnérabilité structurelle accrue face aux aléas climatiques.
La finance prend le contrôle du vivant
Ce terrain fertile pour l’agro-industrie a également profité à la finance mondiale. Les marchés ont vu dans cette complexité un immense potentiel de spéculation. Les traders achètent d’énormes volumes de denrées, les stockent à quai pour raréfier artificiellement l’offre, faire monter les prix… quitte à ce que les cargaisons moisissent partiellement. Elles sont ensuite revendues à des gouvernements ou mélangées à des lots plus frais, au détriment de la qualité nutritionnelle. Ce mécanisme dégrade la valeur calorique des aliments : il en faut plus pour nourrir autant. D’où une surproduction, plus de chimie, plus de machines, plus grosses et plus chères… et encore plus de matière à trader dans ces secteurs apparentés qui se portent d'autant à merveille que les agriculteurs croulent sous les dettes pour suivre le rythme et voient leur revenu s'amoindrir au gré qu'ils ravagent l'environnement en produisant massivement de la mauvaise qualité qui se verra dégradée par la spéculation.
La dégradation devient rentable.
Pire encore, le fonctionnement actuel crée un cercle vicieux pervers : les États subventionnent la production agricole nationale, qui est ensuite achetée par des traders. Ceux-ci la retiennent pour faire monter son cours, ce qui en dégrade la qualité. Les États rachètent ensuite cette même production, plus chère et de moindre qualité, pour en faire de l’aide alimentaire. Ces produits, distribués dans des pays où les agricultures locales ne sont pas subventionnées, viennent concurrencer et ruiner les producteurs locaux. Cela bloque le développement des agricultures nationales, perpétue la dépendance à l’aide, et maintient des situations structurelles de famine.
Une alternative technologique et symbiotique
Aujourd’hui, les technologies numériques offrent une voie de sortie claire. Grâce à Internet et à la blockchain, il devient possible de désolidariser la mondialisation de la production physique. Chaque territoire peut désormais cultiver ce qu’il veut, avec les variétés qui lui conviennent — anciennes, nouvelles, résistantes, bio — sans chercher à tout rendre compatible avec un système centralisé. Chaque production peut être documentée dans un certificat blockchain, garantissant son origine, sa méthode de culture, sa qualité et sa traçabilité. Ces certificats deviennent les unités d’échange mondialisées, non les denrées elles-mêmes. Seules les productions réellement nécessaires pour combler les déséquilibres locaux sont physiquement échangées.
Les bénéfices sont immenses :
- Biodiversité restaurée, écologie renforcée.
- Qualité nutritionnelle retrouvée, spécialités locales valorisées.
- Spéculation encadrée : impossible de laisser pourrir des denrées périssables en espérant une hausse des prix.
- Finance utile, recentrée sur le financement du vivant, et non sa captation.
Surtout, ce modèle rend beaucoup plus accessible le développement d’agricultures locales dans les pays émergents. En cultivant des variétés locales adaptées, sans obligation de correspondre à un standard international, les producteurs peuvent revaloriser leurs savoirs, retrouver leur autonomie, et accéder à des débouchés via les certificats. L’aide ne passe plus par une concurrence déloyale, mais par un accompagnement technique à la transition agroécologique.
Conclusion : une mondialisation du sens, non de la masse
Ce nouveau modèle ne nie pas la mondialisation : il la réinvente. Il ne s’agit plus de tout transporter, uniformiser, mécaniser — mais de mondialiser la confiance, la traçabilité, la connaissance et les flux d’ajustement. Une mondialisation post-industrielle, symbiotique et régénérative, au service des territoires, de la biodiversité, la vie locale, la Vie.
*************************
🧡 Je rappelle que j'accepte les dons. Cela fait maintenant des décennies que je consacre ma vie à mes frais à la transition écologique et sociétale, adoptant une posture oblative littéralement sacrificielle. Ca n'a pas été vain, j'ai réalisé une oeuvre monumentale, offrant une qualité d'information exceptionnelle, ainsi qu'une vision de transition systémique intégrale pour le 21e siècle. Néanmoins, tout ceci m'a mis dans une situation vraiment critique, pour ne pas dire désespérée. J'ai vraiment besoin de vous, merci. 🙏









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Beitragen
Beitragen



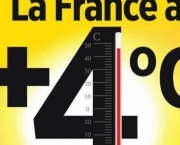

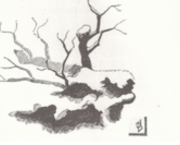




 Du kannst deine Lieblingsautoren unterstützen
Du kannst deine Lieblingsautoren unterstützen






Jackie H vor 5 Monaten
J'avoue que le concept de "réinventer la mondialisation" me plaît beaucoup : faire du local sans pour autant se replier sur soi-même 🙂