
L'ARCHITECTURE SCOLAIRE OU COMMENT L'ECOLE S'EST-ELLE INVENTEE :TROIS PERIODES POUR TROIS TYPES D'ECOLES
 6 min
6 min
L'ARCHITECTURE SCOLAIRE OU COMMENT L'ECOLE S'EST-ELLE INVENTEE :TROIS PERIODES POUR TROIS TYPES D'ECOLES
I. SACRE CHARLEMAGNE ! Jusqu'au XIXe siècle
Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. En réalité, l'école existe depuis bien avant, dès la haute antiquité. Jusqu'au XIXe siècle, l'instruction des enfants, qu'ils soient riches ou pauvres, était principalement assurée par des religieux et des philosophes. Les premières institutions éducatives ont vu le jour en Égypte, puis en Grèce. Architectoniquement, les cours se déroulaient souvent dans de petits bâtiments adjacent à des édifices religieux, dans des forums ou des lieux de culte et de discussion philosophique. Il n'existait pas encore d'architecture scolaire à proprement parler, mais des sites mixtes servant à la fois de lieux de culte, de débats et de transmission des connaissances. À Rome, par exemple, l'école du Magister Ludi accueillait des enfants de 7 à 11 ans, leur enseignant le vocabulaire de la numération et la mimique symbolique des doigts, mais réservant l'arithmétique aux esclaves. Les cours se tenaient dans de petites salles ou des boutiques, séparées par des tissus.
Bien que Charlemagne n'ait pas inventé l'école, il l'a profondément transformée en retranscrivant les manuels d'éducation dans une langue commune, l'écriture caroline minuscule, compréhensible par tous les Francs. Cela a permis aux enfants parlant des dialectes différents d'accéder au savoir, une véritable avancée !
II. ET JULES FERRY ? Du XIXe au XXe siècle
Le XIXe siècle est marqué par l'élaboration de modèles de construction pour les écoles. Les lois sur l'éducation, notamment celles promues par Jules Ferry (Ministre de l'Instruction Publique et Premier Ministre) et Auguste Bouillon, architecte ayant rédigé le premier traité d'architecture scolaire en 1834, influencent le système éducatif français. L'école devient laïque, obligatoire et gratuite pour tous les enfants âgés de 6 à 13 ans. De plus, la Loi Guizot de 1833 impose à chaque commune de maintenir ses bâtiments scolaires, quadrillant ainsi le territoire national de constructions éducatives.
Les écoles « Jules Ferry », construites à cette époque, se distinguent par plusieurs caractéristiques :
- La façade, qui ne cache pas la structure, doit refléter l'autorité et être lisible, car l'éducation est un droit pour tous.
- Chaque établissement regroupe l'école (environ 50 élèves par classe, sans mélange entre filles et garçons), la mairie, les appartements des enseignants et la cantine.
En 1886, la Loi Goblet reprend les recommandations des architectes Bouillon, Pompée et Narjoux concernant la construction, le mobilier et le matériel des écoles maternelles et primaires publiques. Pour assainir les établissements, l'État accorde des aides financières aux communes, avec pour objectif de scolariser massivement les jeunes générations. Jules Ferry reste une figure emblématique du XIXe siècle, car il a transformé l'instruction en éducation, la rendant gratuite, obligatoire et laïque. Pour la première fois, les autorités religieuses perdent le contrôle de l'éducation des enfants, une véritable révolution !
III. DE LE CORBUSIER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE… Du XXe siècle à aujourd'hui
La fin de la Première Guerre mondiale (1914-1918) entraîne une prise de conscience du bien-être des enfants par les autorités sanitaires. Les architectes et ingénieurs s'intéressent alors à ces enjeux, donnant naissance au mouvement hygiéniste. Ce dernier vise à améliorer l'état sanitaire des constructions en augmentant les ouvertures, en renouvelant l'air et en assurant l'accès à l'eau courante, s'inspirant des cités jardins de Tony Garnier (1869-1948). Ces nouvelles écoles favorisent l'ouverture sur l'extérieur, avec l'idée que l'école doit contribuer à la santé et au bien-être des enfants, le secteur public commençant ainsi à soutenir les parents dans leur rôle éducatif. Les travaux de pédagogues tels que Piaget, Montessori ou Freinet influencent les manuels d'aide à la conception.
« L'espace devient modulable, la salle de classe se déstructure pour accueillir diverses activités, tandis que ses limites varient grâce à des cloisons mobiles. L'école s'ouvre davantage sur l'extérieur, et certaines pièces peuvent être mises à la disposition du quartier. » (Michel LAINE, *Les constructions scolaires en France*, ed. PUF, 1996)
La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) oriente l'architecture scolaire vers des constructions plus économiques et rapides. Les destructions causées par les combats nécessitent, dès 1955, la construction ou la reconstruction de 23 266 classes et 1 462 écoles mixtes. L'accent est mis sur une approche économe, privilégiant la rapidité de construction et le faible coût, tout en respectant les normes d'hygiène et d'adaptabilité pour les enfants (circulaire de 1950 : « le mobilier des classes sera individuel, les couleurs gaies et claires, le tableau vert foncé remplacera le tableau noir »). Un prototype est présenté aux constructeurs, avec une trame de 1,75 m, une hauteur sous plafond de 3 m, un couloir central et une économie de matériaux.
Parallèlement, de nouvelles pistes architecturales émergent avec le mouvement moderne, incarné par des figures comme Le Corbusier (1887-1965), qui prône le toit terrasse, les pilotis, les fenêtres en bandeau et la façade libre.
Dès les années 1980, on évoque des écoles sur mesure, respectueuses de leur environnement, avec la Loi Deferre (1982) qui rejette la standardisation. Elle prône un retour à l'architecture, une meilleure compréhension des besoins des enfants et des enseignants, ainsi que l'importance de l'école en tant qu'intégrateur social. L'architecture scolaire met alors l'accent sur l'insertion paysagère, la modularité et la réversibilité des bâtiments en fonction des besoins démographiques, tout en intégrant les principes du développement durable (efficacité économique, équité sociale et respect de l'environnement).
Fanny Azan-Brulhet









 English
English
 Français
Français
 Deutsch
Deutsch
 Italiano
Italiano
 Español
Español



 Contribuisci
Contribuisci












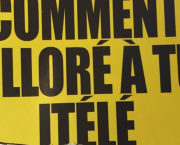

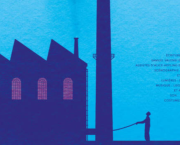
 Puoi sostenere i tuoi scrittori preferiti
Puoi sostenere i tuoi scrittori preferiti






Alexandre Leforestier 9 mesi fa
N'hésitez pas à mettre des tags à vos publications, cela améliore le référencement SEO dans Google et la découvrabilité des contenus dans Panodyssey.
Alexandre Leforestier 9 mesi fa
Très intéressant cet article et le format court est très chouette ! Je m'en vais partager çà... ici et ailleurs !
https://www.linkedin.com/posts/alexandreleforestier_panodyssey-larchitecture-scolaire-ou-comment-activity-7321087268461453313-8EJM?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAADPz-8BHxnWDnyve84H3u6hcKDuDur0ATo